Le jeudi 1er mai 2025
| 17 h 30 à 19 h | Conférence Mark Wainberg – Dr Winston Husbands
Au-delà de l’apaisement : Le VIH, la santé et les promesses d’émancipation des Noirs |
Le vendredi 2 mai 2025
| 9 h à 9 h 45 | Séance plénière sciences fondamentales – Dr Nicolas Chomont
Remède contre le VIH : Du rêve à la réalité? |
| 9 h 45 à 10 h 30 | Séance plénière épidémiologie et sciences de la santé publique – Dr Lawrence Mbuagbaw
Ensemble pour le changement : Appuyer la recherche et l’équité dans le domaine du VIH |
Le samedi 3 mai 2025
| 9 h à 9 h 45 | Séance plénière sciences cliniques – Dr Darrell Tan
La promesse de la PrEP |
| 9 h 45 à 10 h 30 | Séance plénière sciences sociales – Dre Cathy Worthington
Cadres de recherche coopérative en recherche sur le VIH : Expériences collectives et contextes émergeants |
Conférence Mark Wainberg

Au-delà de l’apaisement : Le VIH, la santé et les promesses d’émancipation des Noirs
Date: jeudi 1 mai
Heure: 17:30 – 19:00
Conférencier: M. Winston Husbands (PhD), Professeur associé à l’École de santé publique Dalla Lana de l’Université de Toronto
C’est depuis les années 1990 que M. Winston est actif dans la recherche, la défense et le renforcement des capacités, de même que la mobilisation communautaire concernant le VIH dans les collectivités noires. Actuellement, son travail au sein du comité provisoire sur le VIH affectant les collectivités noires canadiennes (ICHBCC) vise les barrières systémiques et l’indifférence institutionnelle qui normalisent le fardeau excessivement disproportionné qu’assument les Noirs dans l’épidémie canadienne de VIH. Parmi ses appartenances précédentes, mentionnons des rôles de direction dans de grandes organisations communautaires canadiennes du domaine du VIH. M. Winston est professeur associé à l’École de santé publique Dalla Lana de l’Université de Toronto et, auparavant, était chercheur principal au Réseau ontarien de traitement du VIH.
Pour l’essentiel, la politique canadienne sur le VIH et les institutions de recherche en place interprètent faussement le passé, le présent et l’avenir possible de l’épidémie de VIH au Canada. Par conséquent, la vie et les moyens de subsistance des Noirs sont accaparés comme matière brute d’un système supprimant la légitimité des revendications des Noirs à l’équité en matière de santé et de bien-être. Au cours des 35 dernières années au moins, les collectivités noires ont assumé un fardeau largement disproportionné de l’épidémie de VIH du Canada tout en étant écartées de l’effort organisé pour comprendre le VIH et lutter contre. En 2022, un groupe d’érudits noirs du domaine du VIH, de praticiens des soins de santé de première ligne et de défenseurs de la collectivité se sont rassemblés pour rédiger le Black HIV Manifesto et défendre les approches transformatrices pour la recherche et la politique sanitaires concernant le VIH. Dans cet exposé, nous: a) faisons un examen de la crise du VIH naissant de réponses structurellement injustes à l’épidémie, (b) situons l’ICHBCC et son travail dans le concept de l’émancipation des Noirs, et (c) lançons un appel aux collègues Noirs de l’ensemble du Canada pour se mobiliser dans le sens des efforts de l’ICHBCC.
Séance plénière sciences fondamentales
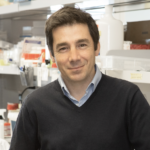 Remède contre le VIH : Du rêve à la réalité?
Remède contre le VIH : Du rêve à la réalité?
Date: vendredi 2 mai
Heure: 09:00 – 9:45
Conférencier: M. Nicolas Chomont (PhD), Département de microbiologie, des maladies infectieuses et de l’immunologie, Université de Montréal, et chercheur, Centre de recherche du CHUM
M. Nicolas Chomont (PhD) est professeur agrégé, Département de microbiologie, des maladies infectieuses et de l’immunologie à l’Université de Montréal, en même temps que chercheur au Centre de recherche du CHUM. Il a obtenu son doctorat à l’Université de Paris en 2004, sa recherche portant sur les mécanismes cellulaires qui sous-tendent la transmission du VIH. Au cours de sa formation postdoctorale, M. Chomont a identifié les sous-ensembles de cellules CD4+T responsables de la persistance du VIH chez les personnes suivant une thérapie antirétrovirale. Actuellement, M. Chomont pilote des études visant à élucider les mécanismes immunologiques qui animent la persistance du VIH et à élaborer des stratégies thérapeutiques innovantes pour éradiquer le virus.
La thérapie antirétrovirale bloque la réplication du VIH et prolonge la vie des personnes vivant avec le VIH (PVVIH). Par contre, elle n’élimine pas le virus et le traitement doit être suivi à vie. En plus des stigmates persistants, le traitement la vie durant suppose à la fois des risques pour la santé pour la PVVIH et un fardeau économique considérable pour la société. Voilà pourquoi nous avons désespérément besoin de mettre au point un remède contre l’infection à VIH.
Le VIH persiste dans des cellules appelées « réservoirs du VIH » pendant toute la vie de la PVVIH. Les réservoirs sont la raison pour laquelle la thérapie antirétrovirale doit être suivie la vie durant. Dans notre quête pour trouver un remède contre l’infection à VIH, il faut soit éliminer complètement ces réservoirs, soit réduire leur taille pour permettre au système immunitaire de les maîtriser naturellement (comme le virus de l’herpès).
Il ressort clairement, après plus de 25 ans de recherche sur les réservoirs de VIH, que la taille du réservoir de VIH diminue lentement avec le temps grâce à la thérapie, mais cette baisse est trop lente pour éliminer le virus au cours de la vie : le VIH se cache dans les cellules qui peuvent proliférer ou persister dans les tissus profonds, par exemple les ganglions lymphatiques et la moelle osseuse. Nous avons mis au point une nouvelle méthode d’analyse permettant de visualiser et de caractériser individuellement les cellules infectées dans le sang et les tissus de la PVVIH. Notre objectif est de préciser les caractéristiques immunologiques et virologiques de ces cellules. Plus particulièrement, nous nous concentrons sur ce qui suit : 1) la nature des cellules dans laquelle le VIH persiste afin de préciser les mécanismes qui mènent à leur persistance et à leur prolifération et 2) la nature du virus pour comprendre de quelle façon il échappe à la reconnaissance du système immunitaire. Au moyen de ces études, nous croyons que nous aurons une meilleure connaissance des facteurs cellulaires et viraux à cibler pour éliminer les réservoirs du VIH.
Objectifs d’apprentissage :
1. Comprendre pourquoi la thérapie antirétrovirale (TAR) n’éradique pas le VIH.
2. Explorer de quelle façon le VIH crée un réservoir viral qui persiste malgré la TAR.
3. Préciser les types de tissus et de cellules où persiste le VIH chez les personnes suivant la TAR.
4. Connaître les stratégies et approches les plus nouvelles mises à l’essai pour parvenir à éradiquer le VIH.
Séance plénière épidémiologie et sciences de la santé publique
 Ensemble pour le changement : Appuyer la recherche et l’équité dans le domaine du VIH
Ensemble pour le changement : Appuyer la recherche et l’équité dans le domaine du VIH
Date: vendredi 2 mai
Heure: 09:45 – 10:30
Conférencier: M. Lawrence Mbuagbaw, Département des méthodes de recherche, des données probantes et des répercussions en santé – Université McMaster, et directeur de l’unité de biostatistique, St Joseph’s Healthcare Hamilton
M. Lawrence Mbuagbaw (PhD) est chercheur en méthodes de recherche et épidémiologiste. Il est professeur agrégé à l’Université McMaster, où il donne des cours en biostatistique, essais aléatoires et synthèse des données probantes. Il est également professeur agrégé exceptionnel en épidémiologie et biostatistique à l’Université Stellenbosch. Il est directeur du centre des méthodes de recherche de l’Institut de recherche de St Joseph’s Health Care Hamilton (SJHH) où il offre un soutien méthodologique et statistique aux autres chercheurs. Ses recherches sur le VIH portent sur la pharmacorésistance, la cascade des soins et l’amélioration des résultats dans les populations vulnérables.
Cet exposé portera sur le rôle essentiel de l’action collective pour l’avancement de la recherche et des soins dans le domaine du VIH dans l’ensemble du Canada. Nous y trouverons un aperçu de l’épidémiologie actuelle du VIH, en faisant ressortir les disparités de soins et les populations sous-représentées, tout en illustrant les succès, par exemple les progrès en matière de thérapie, de prévention et de politique. Tout en rappelant l’importance de la collaboration, nous traiterons de la façon dont les partenariats interdisciplinaires, la mobilisation communautaire et les réseaux nationaux sont à l’origine de progrès appréciables.
Il sera question des stratégies clés pour appuyer la recherche, notamment la promotion du partage et de l’intégration des données, le renforcement des capacités de recherche, la priorité aux démarches fondées sur l’équité et l’adoption de méthodes innovatrices comme la santé publique de précision. Nous présenterons également des exemples de réussites régionales et nationales illustrant les répercussions mesurables des efforts collectifs en matière de politique, de prestation des soins et de stratégies de prévention.
Nous terminerons par un exposé sur les défis, par exemple les obstacles au financement et les silos de données, tout en soulignant les perspectives pratiques pour renforcer la collaboration par la défense, les outils numériques et l’harmonisation des politiques.
Objectifs d’apprentissage :
1. Connaître l’actuel paysage de la recherche sur le VIH au Canada – Mieux cerner les tendances épidémiologiques, les disparités en matière de soins et les domaines exigeant d’urgence notre attention.
2. Reconnaître l’importance des mesures collectives dans les progrès en matière de recherche – Les modalités par lesquelles la collaboration entre chercheurs, cliniciens, communautés et responsables de l’élaboration des politiques peuvent servir l’obtention de résultats concrets.
3. Mettre en évidence les principales stratégies pour appuyer les efforts de recherche sur le VIH – Analyser des approches comme le partage des données, le renforcement des capacités, la recherche axée sur l’équité et les innovations technologiques.
Séance plénière sciences cliniques
 La promesse de la PrEP
La promesse de la PrEP
Date: samedi 3 mai
Heure: 09:00– 09:45
Conférencier: Dr Darrell H. S. Tan, Médecin et chercheur clinicien à l’hôpital St. Michael, Professeur agrégé au Département de médecine et à l’Institut de la politique, de la gestion et de l’évaluation de la santé à l’Université de Toronto
Le Dr Darrell H. S. Tan est médecin du domaine des maladies infectieuses et chercheur clinicien à l’hôpital St. Michael, où il dirige l’Options Collaboratory in HIV/STI Treatment and Prevention Science (www.optionslab.ca). Il est également professeur agrégé au Département de médecine et à l’Institut de la politique, de la gestion et de l’évaluation de la santé à l’Université de Toronto, avec nomination conjointe à l’Institut des sciences médicales. Ses recherches portent sur les essais cliniques et la science de la mise en œuvre dans les domaines de la prévention du VIH, du traitement du VIH et des infections transmises sexuellement (ITS), notamment la mpox. Le Dr Tan est titulaire d’une chaire de recherche canadienne de niveau 2 en prévention biomédicale du VIH/des ITS et codirige le groupe de réflexion sur la prévention et les essais du Réseau canadien pour les essais cliniques sur le VIH et autres ITSS et est membre du conseil de direction de la Société internationale du sida.
On dit souvent que la prophylaxie préexposition (PrEP) a révolutionné notre démarche de prévention du VIH et que c’est la clé pour mettre fin à l’épidémie en tant que menace à la santé publique. Par contre, en a-t-il vraiment été ainsi au Canada? Avons-nous vraiment concrétisé les promesses de la PrEP? Quels sont les obstacles qui nous bloquent? Cet entretien est une récapitulation des immenses progrès techniques que nous avons accomplis dans le domaine de la prévention biomédicale du VIH, tout en offrant des idées sur la façon dont nous pouvons recadrer notre réflexion concernant la PrEP pour mieux harnacher le potentiel transformateur de cette mesure de prévention sécuritaire et efficace.
Objectifs d’apprentissage :
- Revoir les données cliniques récentes sur la sûreté et l’efficacité des formulations PrEP actuelles;
- Dégager les difficultés contre une plus grande efficacité du lancement de la PrEP au Canada, ainsi que les stratégies pour les surmonter;
- Comprendre la valeur du recadrage de la PrEP en tant qu’intervention de santé publique où l’accent porte sur le choix.
Séance plénière sciences sociales
 Cadres de recherche coopérative en recherche sur le VIH : Expériences collectives et contextes émergeants
Cadres de recherche coopérative en recherche sur le VIH : Expériences collectives et contextes émergeants
Date: samedi 3 mai
Heure: 09:45 – 10:30
Conférencier: Mme Cathy Worthington (PhD), école de la santé publique et de la politique sociale, Université de Victoria
Mme Catherine (Cathy) Worthington, PHD, est professeure et directrice de l’École de la santé publique et de la politique sociale à l’Université de Victoria. Elle a dirigé des recherches de mobilisation communautaire en partenariat avec les collectivités touchées par l’épidémie de VIH depuis plus de 20 ans. Le principal de son travail porte sur la mise au point de services dirigés par la collectivité, sur l’exclusion/l’inclusion sociale que subissent les personnes vivant avec le VIH (emploi, la réduction des stigmates, le logement, les handicaps) et l’apprentissage sur les méthodes de mobilisation communautaires par la collaboration avec les personnes vivant avec le VIH, les agences communautaires et les partenaires dela politique. Elle a fait partie de nombreux réseaux de recherche nationaux et régionaux sur le VIH/les ITSS.
Dès le début de l’épidémie de VIH, les personnes vivant avec le virus ont demandé d’être à la table de recherche et les principes GIPA/MEPA (Greater Involvement and Meaningful Engagement of People living with HIV) ont fait en sorte que la recherche sur le VIH a acquis d’entrée les approches de mobilisation de la collectivité. Au cours des deux dernières décennies, ces approches sont passées d’initiatives marginales à une forme de recherche de premier plan au Canada, non seulement dans la recherche sur le VIH, mais aussi la recherche sur l’équité en matière de santé et plus largement, la recherche en santé. Les équipes de chercheurs disposent maintenant d’une vaste gamme d’approches de mobilisation communautaire parmi lesquelles choisir, notamment la recherche participative communautaire, la recherche axée sur le patient, la science de la mise en œuvre participative, la conception conjointe et la science citoyenne. Les méthodologies autochtones et les approches en recherche antiraciste ont généré parallèlement une souche distincte des approches de mobilisation communautaire. Dans chacune de ces approches, on relève des points communs, de même que des fins, caractéristiques, forces et faiblesses distinctes qui ont des répercussions sur la structure des équipes, les processus de partenariat, les résultats de la recherche et l’action collective.
Cet exposé offre un bref aperçu des approches de mobilisation communautaire et fait appel à deux cadres de ce domaine, à savoir la recherche participative communautaire (RC) et la science de la mise en œuvre participative – pour décrire et illustrer, à l’aide d’exemples issus de la recherche sur le VIH, les réalités, les tensions et les résultats de l’application de ces cadres. Puisque, naturellement, les approches de mobilisation communautaire ne cessent d’évoluer, nous aborderons les contextes récents et naissants de ce domaine de recherche, y compris la montée de l’IA/IA génératrice, la pensée systémique, un climat politique changeant/régressif, les pressions de l’infrastructure universitaire et le changement générationnel de prise de position dans la recherche.
Objectifs d’apprentissage :
1. Faire mieux connaître divers cadres d’approches de recherche mobilisant la collectivité dans le domaine du VIH.
2. Mieux comprendre les avantages et les défis du recours aux différentes approches de ce type de recherche.
3. Possibilité d’évaluation critique/d’autoréflexion sur la structure des équipes, les processus de partenariat et les résultats des approches de recherche mobilisant la collectivité.
4. Examiner les contextes naissants, les innovations et les défis de la recherche mobilisant la collectivité dans la recherche sur le VIH et la santé.
